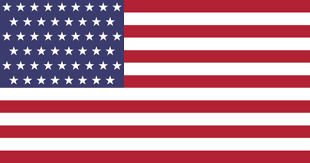La route des rhums : Histoire, AOC, Distilleries et Spiritourisme sur l’Île aux Fleurs
31/03/2022Petite production, grande réputation… L’histoire des rhums de la Martinique, les seuls au monde à avoir décroché une AOC ( Appellation d’origine contrôlé) , est une vraie success-story. D’une distillerie à l’autre, d’une habitation à l’autre, l’île vous offre un fabuleux voyage dans le temps.
A chaque heure, son rhum et son appellation non contrôlée ! Paré pour le « dékolaj » ? C’est le premier rhum de la journée. Le « lave gorge » est le rhum de l’apéritif. Tandis que le « pété pié » est un coupe-jarret, en somme le rhum de trop. Il y a aussi celui qu’on a baptisé, allez savoir pourquoi, « l’heure du Christ », celui de 15 heures. Mais à partir de 16 heures, on passe au « domino », qui accompagne encore dans les cafés de campagne les parties de dominos, où l’on s’efforce de mettre son adversaire « cochon », c’est-à-dire en complet échec. La « partante », c’est, bien sûr, la dernière rasade pour la piste…
En Martinique, le rhum ne colore pas seulement les mots au quotidien. Ce sont aussi des images, des sons, des odeurs, bref tout un univers. Même si aujourd’hui, la culture de la canne à sucre, avec 3 825 hectares, se retrouve reléguée à la seconde place, derrière celle de la banane. Dans l’île, la graminée géante qui est une vraie « petite usine à sucre », nous offre des paysages de carte postale. En décembre, au moment de la floraison de la canne, le regard survole des champs en damiers, dont les plumets blancs soyeux, frissonnent sous le souffle tiède des alizés.
VOUS CHERCHEZ UN COIN DE PARADIS… ELLE VOUS OFFRIRA VOS PLUS BELLES RENCONTRES
UNIQUE ! Le rhum agricole martiniquais est le seul au monde à bénéficier d’une AOC, gage de sa qualité mais aussi de la provenance de la canne et du respect des étapes de culture et de production.
Le rituel du ti-punch
On ne laisse à personne d’autre le soin de préparer son ti-punch (un « feu » dans le parler créole). Il vous faut 1/8ede citron vert, une cuillerée à café de sucre ou de sirop de canne. Le tout est à « touiller » avec un « bwa lélé » (un bâtonnet de bois), avant d’ajouter 5cl e rhum agricole. Pas de glaçons : pour les puristes c’est un vrai pêché ! A déguster en prenant son temps.
Sous un ciel d’un bleu intense, le spectacle donné par ces « flèches de canne » est de toute beauté. Ensuite, de mi-janvier jusqu’en juillet, cette mer végétale est livrée au coutelas des ramasseurs ou à d’énormes tracteurs-moissonneurs, fauchant les tiges pour les recracher dans une benne. L’air s’emplit d’une « odeur végétale, herbacée, florale, légèrement poudrée et miellée » : hors saison, vous la retrouverez dans un étonnant parcours olfactif mis en place à la distillerie J.M., à Macouba, dans le nord de l’île.
L’ancêtre du rhum
Macouba, justement… Ici, débarque en 1694 un missionnaire dominicain, le père Jean-Baptiste Labat (1663-1738). L’île, sur laquelle les Français ont mis la main en 1635, connaît déjà la fièvre du sucre. Mais le rhum, pas encore. A lire le père Labat*, il y a bien une « eau de vie que l’on tire des cannes […] appelée guildive. Les sauvages et les nègres l’appellent tafia ; elle est très forte et a une odeur désagréable, et de l’âcreté […] qu’on a de la peine à lui ôter ». Bref, cet ancêtre du rhum a tout du tord-boyaux, le nom étant probablement dérivé de kill devil (tue-diable), ce qui trahit la force de l’alcool.
Dans son exploitation sucrière de Fonds-Saint-Jacques à Sainte-Marie, le père Labat, qui es un touche-à-tout, va consacrer beaucoup de temps à améliorer ce tafia. Mais pour soigner les fièvres, honni soit qui mal y pense. « Il a fait venir du matériel en cuivre depuis la France et a su l’adapter », raconte Alain Huetz de Lemps dans son histoire du rhum. Les alambics dits du père Labat vont connaître un succès fou dans toutes les Antilles françaises.
La canne à sucre pour faire du sucre mais pas seulement !
« L’histoire de la Martinique a pratiquement commencé avec la canne », nous rappelle Michel Fayad, un historien passionné, qui a fini par mettre les mains dans la mélasse, pour diriger le musée du rhum à Sainte-Marie et coordonner la rénovation du château Depaz à Saint-Pierre. La canne, ce fut d’abord pour le sucre, ensuite pour le rhum. L’île a tout connu : des succès flamboyants, des revers cuisants, au fil des cours du sucre qui s’effondrent et des contingentements à l’export imposés sur le rhum. A la fin du XIXè siècle, la Martinique devient même le producteur de rhum du monde, exportant 190210 hectolitres de cet alcool à 55° en 1892. En 1945, on dénombrait encore 145 distilleries.
Aujourd’hui, la Martinique n’en compte plus que 7, dites « fumantes », c’est-à-dire en activité : J.M à Macouba, Depaz à Saint-Pierre, qui produit aussi e rhum Dillon, Neisson au Carbet, La Favorite au Lamentin, La Mauny à Rivière-Pilote, Le Simon au François, Saint-James à Sainte-Marie. Ensemble, en 2016, elles ont produit un peu plus de 89000 hectolitres (en alcool pur, à 100%) de rhum agricole.
Vesou contre mélasse
Mais derrière les chiffres se cache une profonde évolution, celle que le rhum martiniquais a opérée dans l’imaginaire de ses consommateurs. Au départ, inutile de le cacher : c’était la boisson des « nègres » qui voulaient oublier leur condition d’esclaves et celle de ces flibustiers des Caraïbes qui finissaient tôt ou tard au bout d’une corde. « C’est resté un alcool de détresse jusque dans les années 1980. Celui des chagrins d’amour, celui des veillées d’enterrement », souligne Michel Fayad.
Pour Nathalie Guillier-Tual, présidente de Bellonieet Bourdillon Succcesseurs (Maison La Mauny, Trois-Rivières), le rhum, c’est désormais tout autre chose : « Un alcool, synonyme de fête et de partage, qui évoque l’exotisme et la décontraction… » Aujourd’hui, la Martinique encaisse les dividendes d’une politique ambitieuse. Elle a privilégié le rhum agricole, le rhum pur produit du jus de la canne (le fameux vesou) mis à fermenter et à distiller, et ceci au détriment du « rhum de sucrerie », tiré des résidus du raffinage du sucre (la mélasse). Elle est surtout le seul pays au monde à avoir décroché en 1996 une AOC (Appellation d’origine contrôlée) pour son rhum. Dans ce succès, Michel Fayad veut voir « la french touch », faite d’audaces et raffinement.
Des rhums pour la France et l’UE
La Martinique produit plus de 13 millions de bouteilles de rhum par an. La moitié est consommée en métropole. Un quart reste sur place, le dernier quart est exporté en Union européenne.
Il existe désormais différents rhums et chacun à sa spécificités
Rhums blancs : D’une teinte transparente. Reposé quelques mois dans une cuve inox pour stabiliser les arômes. Le Rhum blanc est souvent utiliser pour le Ti-punch avec du sucre et du citron , on le prend aussi pour agrémenter nos cocktails et nos liqueurs
Rhums Ambrés : D’une teinte dorée. Entre 6 semaines à 3 ans de rpos dans un foudre de chêne souvent ayant contenu du bourbon ou whisky. Plus complexe que le rhum blanc, avec des notes de vanille, de caramel, d’épices et parfois de fruits secs. Peut être utilisé dans les cocktails plus élaborés ou consommé pur ou sur glace pour apprécier ses arômes plus développés.
Rhums Vieux : D’une teinte brune. Reposé entre 3 ans à des décennies dans des fûts de chêne souvent ayant contenu du bourbon ou whisky. Très riche et complexe, avec des notes de bois, de vanille, de fruits secs, d’épices, de cacao, parfois de tabac et de cuir. Souvent dégusté pur pour révéler toutes ses nuances aromatiques, idéal pour les amateurs de spiritueux de qualité.
Le « spiritourisme » ? Les rhums à l’honneur
L’île s’est aussi lancée très tôt dans ce qu’on appelle aujourd’hui le spirit tourisme (le tourisme des spiritueux). Ouvrant ses habitations, ses anciens domaines (l’habitation Clément, le château Depaz) et ses distilleries. Le visiteur de passage peut rêver tout son soûl à ces grands propriétaires, Békés, Français ou Créoles, qui héritaient d’esclaves comme autant de biens meubles. Un peu décontenancé, il découvre, devant les colonnes de distillations bichonnés comme des bijoux, qu’aucun rhum en Martinique ne ressemble à un autre. « Une foule de paramètres entre en jeu. Le terroir, les vari étés de cannes, les amplitudes thermiques… Chacun a son savoir-faire », explique Michel Fayad, intarissable. Les anges, eux, se contentent de prélever leur part : entre 7 et 10% s’évaporent dans la nature pour ces goulus !
*Nouveau voyage aux îles de l’Amérique (1722).
46/ DESTINATION MARTINIQUE
Réservez dès maintenant vos excursions en Martinique , goutez les rhums et vivez des aventures inoubliables sur notre île paradisiaque. Contactez-nous pour plus d’informations et planifiez votre séjour avec nous !